"If we wish to stop the atrocities, we need merely to step away from the isolation. There is a whole world waiting for us, ready to welcome us home." Derrick Jensen
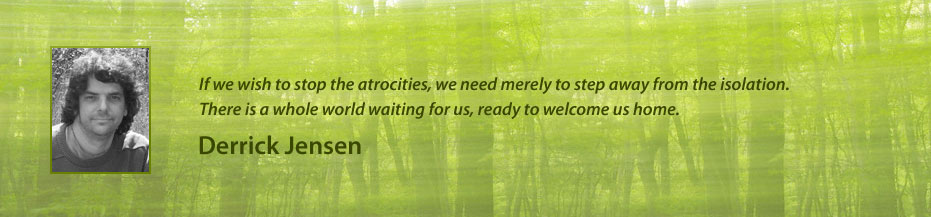
-
See the Archives
- March 2023
- September 2019
- August 2019
- March 2019
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- May 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
- December 2016
- October 2016
- September 2016
- August 2016
- March 2016
- January 2016
- December 2015
- November 2015
- August 2015
- July 2015
- June 2015
- March 2015
- February 2015
- January 2015
- November 2014
- October 2014
- August 2014
- May 2014
- April 2014
- March 2014
- January 2014
- December 2013
- November 2013
- October 2013
- September 2013
- July 2013
- June 2013
- May 2013
- March 2013
- January 2013
- September 2012
- July 2012
- May 2012
- February 2012
- January 2012
- December 2011
- September 2011
- August 2011
- July 2011
- May 2011
- March 2011
- February 2011
- January 2011
- December 2010
- November 2010
- September 2010
- July 2010
- June 2010
- May 2010
- March 2010
- January 2010
- December 2009
- November 2009
- October 2009
- September 2009
- July 2009
- May 2009
- February 2009
- January 2009
- November 2008
- September 2008
- August 2008
- June 2008
- February 2008
- December 2007
- November 2007
- October 2007
- June 2007
- May 2007
- April 2007
- March 2007
- January 2007
- November 2006
- October 2006
- September 2006
- August 2006
- July 2006
- June 2006
- May 2006
- January 2006
- September 2005
- July 2005
- April 2005
- December 2004
- September 2004
- July 2004
- May 2004
- March 2004
- February 2004
- November 2003
- October 2003
- July 2003
- June 2003
- May 2003
- March 2003
- February 2003
- November 2002
- July 2002
- June 2002
- May 2002
- March 2002
- February 2002
- December 2001
- October 2001
- August 2001
- July 2001
- April 2001
- March 2001
- February 2001
- December 2000
- November 2000
- October 2000
- September 2000
- July 2000
- June 2000
- May 2000
- April 2000
- March 2000
- January 2000
- December 1999
- November 1999
- September 1999
- August 1999
- March 1999
- October 1998
- September 1998
- August 1998
- May 1998
- November 1997
- July 1997
- April 1997
- January 1997
- October 1996
- May 1996
- April 1996
- October 1995
- March 1995
- April 1991
- Filter by Category
Un langage plus ancien que les mots
January 1st, 2000Aborder l’ineffable
« Un langage plus ancien que les mots » devait initialement aborder le fait que nombre d’entre nous font l’expérience de communications inter-espèces au quotidien, mais que presque personne n’en parle publiquement. Ce livre allait être une collection d’histoires heureuses de communication inter-espèces, mais j’ai très rapidement réalisé qu’écrire un livre heureux à propos de relations humaines et non-humaines serait, au point où nous en sommes, profondément malhonnête. De plus, un livre visant à montrer que les non-humains peuvent penser et communiquer serait profondément sectaire et dégradant, comme si quelqu’un écrivait un livre montrant que les blondes peuvent penser, ou que les juifs ne sont pas des sous-humains. Cela permettrait au chauvinisme et au sectarisme de la culture dominante de demeurer incontestés.
A la place, j’ai cherché à répondre aux questions suivantes : pourquoi certains d’entre nous écoutent, et d’autres non? Pourquoi certaines personnes se fichent-elles de ceux qu’elles exploitent? Pourquoi exploitent-elles? J’ai réalisé qu’avant de pouvoir exploiter l’autre, vous devez le réduire au silence. C’est à ce moment-là que le livre s’est transformé en ce qu’il est devenu.
Il existe un langage bien plus ancien et plus profond que les mots. C’est le langage des corps, d’un corps contre un corps, du vent sur la neige, de la pluie sur les arbres, des vagues sur les rochers. C’est le langage du rêve, du geste, du symbole, du souvenir. Nous avons oublié ce langage. Nous ne nous souvenons même plus qu’il existe.
Afin de maintenir notre mode de vie, nous devons, au sens large, nous mentir les uns aux autres, et particulièrement à nous-mêmes. Il n’est pas nécessaire que les mensonges soient particulièrement plausibles. Les mensonges servent de remparts contre la vérité. Ces remparts contre la vérité sont nécessaires, parce que, sans eux, de nombreux actes déplorables deviendraient impossibles. La vérité doit à tout prix être évitée. Quand nous permettons à des vérités évidentes de passer outre nos défenses et de pénétrer dans nos consciences, elles sont traitées comme autant de grenades roulant sur la piste de danse d’une improbable fête macabre. Nous tentons de rester hors de danger, de peur qu’elles n’explosent, brisent nos illusions, et nous laissent face à ce que nous avons fait au monde et à nous-mêmes, face aux personnes creuses que nous sommes devenus. & nous évitons donc ces vérités, ces vérités flagrantes, et continuons la danse de la destruction du monde.
Comme c’est le cas pour la plupart des enfants, quand j’étais jeune, j’entendais le monde parler. Les étoiles chantaient. Les pierres avaient des préférences. Les arbres avaient des mauvais jours. Les crapauds tenaient des débats animés, se vantant de la bonne prise de la journée. Comme des bruits parasites à la radio, l’école ainsi que d’autres formes de socialisation commencèrent à interférer avec ma perception du monde animé, et pendant de nombreuses années j’ai presque cru que seuls les humains parlaient. Le fossé entre ce dont j’avais fait l’expérience et ce que je croyais à peu près me perturbait profondément. Ce n’est que plus tard que j’ai commencé à comprendre les implications personnelles, politiques, sociales, écologiques et économiques de vivre dans un monde réduit au silence.
Ce mutisme imposé est au cœur des rouages de notre culture. Ce farouche refus d’entendre les voix de ceux que l’on exploite est essentiel pour que nous les dominions. La religion, la science, la philosophie, la politique, l’éducation, la psychologie, la médecine, la littérature, la linguistique et l’art ont tous été mis à contribution en tant qu’outils de rationalisation de la réduction au silence et de l’avilissement des femmes, des enfants, des autres races, des autres cultures, du monde naturel et de ses membres, de nos émotions, de nos consciences, de nos expériences et de nos histoires culturelles et personnelles.
Ma propre introduction à ce mutisme imposé — et il en va de même pour un grand pourcentage d’enfants au sein de nombreuses familles — se fit des mains (et des parties génitales) de mon père, qui battait ma mère, mes frères et mes sœurs, et qui violait ma mère, ma sœur, et moi-même. Je ne peux que spéculer qu’étant le plus jeune, mon père a alors en quelque sorte jugé plus approprié qu’au lieu de me battre, il me forcerait à regarder, et à écouter. Je me souviens de scènes — vaguement, comme d’un rêve ou d’un film — des bras gesticulants, de mon père pourchassant mon frère Rob autour de la maison. Je me souviens de ma mère tirant mon père dans leur chambre afin de recevoir les coups qui auraient autrement fini sur ses enfants. Nous nous asseyions dans la cuisine, visages de marbre, audience attentive des gémissements étouffés qui s’échappaient à travers les murs trop fins.
C’est de cette imprécision avec laquelle je me remémore ces images formatrices dont il est ici question, parce que la pire chose que mon père ait fait va au-delà des coups et des viols, jusqu’au déni que quoi que ce soit ait eu lieu. Non seulement des corps furent brisés, mais brisé aussi fut le socle de la connexion entre mémoire et expérience, entre psyché et réalité. Son déni faisait sens, non seulement parce qu’une reconnaissance de la violence aurait porté préjudice à son image d’avocat respecté, prospère et profondément religieux, mais plus simplement parce que l’homme qui bat ses enfants ne pourrait pas en parler honnêtement et continuer à le faire.
Nous devinrent une famille d’amnésiques. L’esprit ne contient pas la place pour enregistrer ces expériences, et puisqu’il n’y avait vraisemblablement aucune échappatoire, nous souvenir de ces atrocités n’avait aucun intérêt. Nous avons donc appris, jour après jour, à ne pas faire confiance à nos perceptions, et qu’il valait mieux pour nous que nous n’écoutions pas nos émotions. Quotidiennement nous oubliions, et si un souvenir remontait à la surface, nous oubliions à nouveau. Il y avait des coups, suivis d’une bref contrition et de mon père qui demandait « pourquoi m’as-tu poussé à le faire? », et ensuite? Rien, sauf les preuves gênantes: une porte cassée, des sous-vêtement imbibés d’urine, une cloison en bois que mon frère avait arrachée à maintes reprises en essayant de gagner de la vitesse en abordant l’angle. Une fois celles-ci réparées, il n’y avait plus rien pour se souvenir. Nous « oubliions » donc, et le schéma se reproduisait.
La volonté d’oublier est l’essence de la réduction au silence. Comprenant cela, j’ai commencé à faire plus attention au « comment » et au « pourquoi » de l’oubli — a donc commencé un voyage vers le souvenir.
Qu’oublions nous d’autre? Pensons-nous à la dévastation nucléaire, ou à la sagesse de produire des tonnes de plutonium, létal même en doses microscopiques pour bien plus de 250 000 ans? Le réchauffement climatique envahit-il nos rêves? Dans nos moments les plus sérieux, considérons-nous le fait que la civilisation industrielle a initié la plus importante extinction de masse de l’histoire de la planète? Pensons-nous souvent au fait que notre culture commette des génocides contre toutes les cultures indigènes qu’elle rencontre? Lorsqu’un(e) de nous consomme des produits fabriqués par notre culture, se soucie-t-il (ou elle) des atrocités qui les rendent accessibles?
Nous n’arrêtons pas ces atrocités, parce que nous n’en parlons pas. Nous n’en parlons pas, parce que nous n’y pensons pas. Nous n’y pensons pas, parce qu’elles sont trop horribles à concevoir. Comme l’expert en traumatisme Judith Herman l’écrit, « la réponse ordinaire à ces atrocités est de les bannir de la conscience. Certaines violations du pacte social sont trop horribles pour être énoncées à voix haute: c’est la signification du mot ineffable. »
Tandis que le tissu écologique du monde naturel s’effile autour de nous, peut-être est-il temps de commencer à parler de l’ineffable et d’écouter ce que l’on a jugé inécoutable.
Traduction: Nicolas CASAUX
Filed in Français